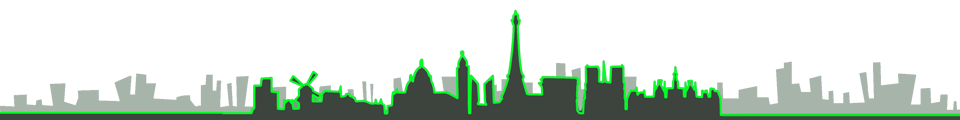Le collège de la Sorbonne
Un collège fondé au XIIIe siècle
Faisant partie de l’Université de Paris, le collège de Sorbonne est fondé en 1253 par Robert de Sorbon, chapelain du roi Louis IX (saint Louis). Il accueille des docteurs en théologie et des bacheliers en théologie. Le collège devient le siège de l’Université de Paris à la fin du XIIIe siècle.

La chapelle et la cour de la Sorbonne @Christel Dardelet
Une reconstruction dans le style classique
En 1626, le cardinal de Richelieu (1585-1642), principal ministre d’Etat de Louis XIII et proviseur du collège, décide de faire reconstruire les bâtiments très délabrés autour de deux cours de part et d’autre de l’ancienne chapelle. Le projet est confié à l’architecte Jacques Lemercier (1585-1654). En 1629, une première cour est achevée au nord.

La chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne : façade donnant sur la place de la Sorbonne
Une nouvelle chapelle pour abriter son mausolée
Mais en 1630, Richelieu, au fait de sa gloire, poursuit un projet plus ambitieux : construire une nouvelle chapelle qui donnera sur une seule cour et dans laquelle sera installé son futur mausolée. Mélange de traditions françaises et italiennes, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne est élevée entre 1634 et 1642 sur les plans de Lemercier et présente deux façades grandioses : l’une donne sur la place de la Sorbonne, l’autre sur la grande cour du collège. Les travaux sont menés par l’entrepreneur Jean Thiriot, très actif à Paris à cette époque. Richelieu meurt en décembre 1642 et ne verra pas son œuvre achevée. C’est sa nièce, la duchesse d’Aiguillon, qui en surveillera les travaux. Fermée depuis 25 ans, la chapelle va faire à compter de 2025 l’objet d’une restauration intérieure grâce à la contribution du Word Monuments Fund (WMF). Elle devrait (enfin!) rouvrir au public en 2030.
Le tombeau de Richelieu
Placé dans le chœur de la chapelle, le tombeau du cardinal de Richelieu est réalisé après sa mort par le grand sculpteur François Girardon et achevé en 1694 : sur une vasque de marbre blanc repose le corps du cardinal soutenu par la figure de la religion.

La cour de la Sorbonne @Christel Dardelet
La nouvelle Sorbonne
A la fin du XIXe siècle, l’ancien collège est intégré à la Nouvelle Sorbonne construite par l’architecte Henri-Paul Nénot (1853-1934) entre 1889 et 1901. L’université occupe désormais l’ensemble de l’îlot formé par la rue Saint-Jacques, la rue Cujas, la rue Victor Cousin, la rue de la Sorbonne et la rue des Ecoles. Située rue des Ecoles, l’entrée principale ouvre sur le grand vestibule donnant accès au grand amphithéâtre (1889) décoré d’une grande toile marouflée « Le Bois Sacré« de Puvis de Chavannes.

L’amphithéâtre Richelieu ou Grand Amphithéâtre de la Sorbonne
Le siège de trois universités
Après mai 1968, les universités sont réorganisées. L’université Paris-Sorbonne (Paris IV) est spécialisée dans les lettres, les arts et les sciences humaines : elle occupe le site historique de la nouvelle Sorbonne. En 1970, l’université Sorbonne Nouvelle (Paris III) est créée : on y enseigne les lettres, les sciences du langage, les langues, les arts du spectacle, la communication et les études européennes. L’établissement occupe une partie du site historique de la nouvelle Sorbonne et bientôt le site Censier. En 2018, les universités Paris-Sorbonne et Pierre-et-Marie Curie (Paris VI) sont regroupées et deviennent Paris-Université. La Sorbonne est également le siège de l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I).
Pour l’architecte Jacques Lemercier, voir également le Palais-Royal, le Palais du Louvre, le temple de l’Oratoire du Louvre, l’abbaye du Val-de-Grâce, le Palais du Luxembourg, la chapelle Sainte-Ursule de la Sorbonne, l’hôpital du Kremlin-Bicêtre.
Pour l’entrepreneur et architecte Jean Thiriot, voir également l’hôtel Mégret de Sérilly, l’hôtel d’Hozier, l’hôtel de Loynes, l’hôtel de Marle, l’hôtel de Canillac, l’hôtel Duret de Chevry, l’hôtel Tubœuf, l’hôtel de Lauzon, l’hôtel de Vigny, l’hôtel Boula de Quincy.
Pour l’architecte Henri-Paul Nénot, voir également l’hôtel Blumenthal-Montmorency, le siège de la banque Louis Dreyfus, l’hôtel Meurice, l’institut océanographique de Paris, Chimie ParisTech, l’institut Curie, l’institut de géographie, les immeubles rue Edouard VII, le Grand hôtel, Immeuble industriel rue du faubourg du Temple, les HBM rue de Belleville.
Source :
Guide du Patrimoine Paris, sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, Paris, Hachette, 1994.
Adresse : rue des Ecoles
Métro : Luxembourg (RER B)
Arrondissement : 5e
Téléphone :