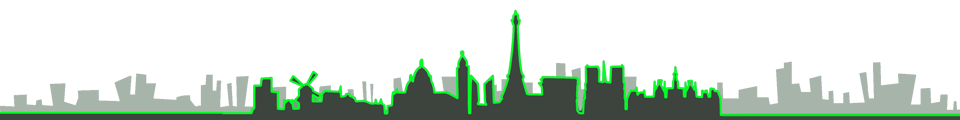Le couvent de la Merci

Le couvent de la Merci vu de la cour de l’hôtel de Soubise : il a la physionomie d’un hôtel particulier
L’Ordre de Notre-Dame de la Merci
L’Ordre des Mercédaires ou Ordre de Notre-Dame de la Merci est fondé en 1223 à Barcelone par un religieux languedocien, Pierre Nolasque, avec l’appui du roi Jacques 1er d’Aragon. Cet ordre se consacre au rachat des chrétiens captifs réduits en esclavage par les pirates. Les membres doivent également accepter de participer à des opérations militaires pour les libérer.

Le couvent de la Merci : le corps de logis en fond de cour
Avec la disparition de la piraterie, l’ordre va se transformer en ordre missionnaire et caritatif. Les Mercédaires vont notamment participer à l’évangélisation du Nouveau Monde.

Le couvent de la Merci : l’aile droite
Les religieux de la Merci dans le Marais
En 1613, la reine Marie de Médicis fait installer les religieux de la Merci à l’emplacement de l’hôpital de Braque. L’architecte Charles Chamois est chargé de construite le couvent (au n°45 de la rue) et l’église (au n°47).

Le couvent de la Merci : l’aile gauche
Vers 1729-1731, de nouveaux bâtiments sont édifiés sur les dessins de l’architecte Pierre-François Godot : derrière un beau portail surmonté d’une corniche, ils sont disposés en U autour d’une cour à la manière d’un hôtel particulier.

Le couvent de la Merci : le grand escalier à vide central
Les façades de pierre blonde présentent une grande sobriété justifiée par le caractère religieux de l’édifice. On remarque la présence de deux cadrans solaires sur la façade nord et la façade ouest. Dans le logis, le magnifique escalier à vide central a été préservé.

Le couvent de la Merci : cadran solaire
L’église du couvent est également reconstruite à la même époque. Sa façade est achevée en 1709 sur les dessins de Germain Boffrand, l’architecte du prince de Soubise qui réside juste en face, à l’hôtel de Soubise.

Le couvent de la Merci : le portail
Le démantèlement à la Révolution
L’église a été démolie à la Révolution. Les bâtiments du couvent sont voués à l’habitation et au commerce au XIXe siècle. Ils ont été habilement restaurés et sont maintenant séparés en appartements. En principe, la cour de l’ancien couvent est accessible en semaine.
Pour l’architecte Charles Chamois, voir également l’hôtel de Lauzun.
Pour l’architecte Germain Boffrand,voir également l’hôtel Le Brun, l’hôtel de Soubise, l’hôtel de Seignelay, l’hôtel Amelot de Gournay, l’hôtel de Beauharnais, l’hôtel de la Chancellerie d’Orléans, l’hôtel de Villars, les trésors cachés du Petit Luxembourg.
Sources :
Chadych (Danielle), Le Marais, évolution d’un paysage urbain, Paris, Parigramme, 2010.
Gady (Alexandre), Le Marais, guide historique et architectural, Paris, Le Passage, 2004.
Adresse : 45 rue des Archives
Métro : Rambuteau
Arrondissement : 3e
Téléphone :