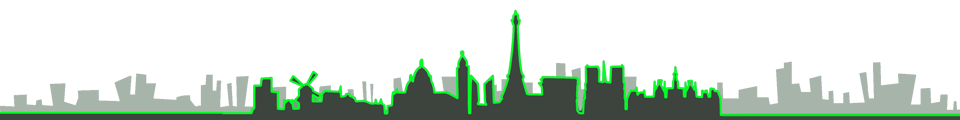Le collège des Bernardins

Le collège des Bernardins : le grand vaisseau donnant sur la rue de Poissy.
Une révolution intellectuelle en Europe
Au XIIè siècle, une révolution intellectuelle secoue l’Europe. Jusqu’alors, les monastères abritaient les principaux centres intellectuels. Ils cèdent peu à peu le pas aux Universités créées dans les grandes villes : Bologne (la plus ancienne) puis Paris, Oxford, Cambridge, Heidelberg. Pour l’Église catholique, il apparaît indispensable d’accompagner ce déplacement du centre de gravité du savoir vers les villes. Dans une bulle de 1245, le pape Innocent IV encourage vivement les cisterciens à aller faire des études à Paris pour y étudier la théologie et transmettre ensuite leur enseignement à leurs confrères.

Le collège des Bernardins : l’ancien réfectoire des moines
Le collège des Bernardins
Etienne de Lexington, abbé de Clairvaux, est un moine d’origine anglaise. En 1245, il fonde le Collège Saint-Bernard qui prend bientôt le nom de Collège des Bernardins. Le collège est destiné à servir de lieu d’étude et de recherche pour la pensée chrétienne. Entre le XIIIe et le XVe siècle, le collège va former plusieurs milliers de jeunes moines cisterciens venus du Nord de la France, de Flandre, d’Allemagne et d’Europe centrale pour étudier la théologie et la philosophie. Ainsi Jacques Fournier, ancien étudiant du Collège, reçu docteur en théologie vers 1314, est plus connu sous le nom de Benoît XII, pape en Avignon de 1334 à 1342. Pendant plus de quatre siècles, le Collège des Bernardins contribue au rayonnement intellectuel de la ville et de l’Université de Paris.

Le collège des Bernardins : l’ancienne sacristie sert de lieu d’exposition
Un bel exemple d’architecture cistercienne
La construction du collège démarre en 1245 sur le modèle architectural des abbayes cisterciennes. Mais il est en partie reconstruit à partir de 1336. Le grand vaisseau visible rue de Poissy abrite l’ancien réfectoire et au premier étage l’ancien dortoir des moines entièrement réaménagé. La salle du réfectoire comprend trois nefs. Son plafond voûté à croisées d’ogives repose sur de fins piliers de pierre. Au sous-sol, le cellier à trois nefs qui avait été comblé à mi-hauteur pour stabiliser l’édifice a été dégagé; il a retrouvé son volume d’origine. La sacristie du XIVe siècle a également été préservée et sert de cadre aux expositions temporaires. Enfin, un admirable escalier à vide central reposant une voûte sarrasine a été réalisé au XVIIIe siècle par l’architecte Bourgeois. Vendu comme bien national à la Révolution, le collège est a subi bien des vicissitudes : il a été successivement transformé en prison, entrepôt, caserne de pompiers puis internat pour l’École de police. En 1855, le percement du boulevard Saint-Germain a signé la destruction de la chapelle du collège.

Le collège des Bernardins : l’escalier à vide central du XVIIIe siècle
Un lieu de rayonnement de la Chrétienté
Sous l’impulsion du diocèse de Paris, l’ancien Collège des Bernardins est minutieusement restauré à partir de 2004 sous la direction conjointe de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, Hervé Baptiste, et de l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Aujourd’hui, le collège renoue avec sa vocation initiale : c’est à la fois un lieu de réflexion et un lieu de rayonnement de la Chrétienté. Il abrite notamment un centre de formation théologique et biblique et depuis 2009 l’Académie catholique de France. Deux auditoriums et des salles de cours ont été créés pour organiser concerts, colloques, conférences et enseignement.

Le collège des Bernardins
Visiter le collège et ses expositions
La nef du réfectoire et la sacristie sont librement ouverts à la visite du lundi au samedi de 10h à 18h. Des visites guidées sont proposées le mercredi, vendredi et samedi à 16h. Des expositions temporaires y sont régulièrement organisées. Il est également possible d’y déjeuner à la « Table des Bernardins » ouverte de 12h à 14h30.

Le collège des Bernardins : façade donnant sur la rue de Poissy
Pour l’architecte Jean-Michel Wilmotte, voir également l’Institut du Cerveau, l’hôtel Mandarin Oriental, le centre spirituel et culturel russe, le siège du Ministère de la Défense, Station F, l’hôtel Lutétia, la maison de la Mutualité, Immeuble mixte rue de Venise, le Grand Palais Ephémère, le campus de Sciences Po.

Le collège des Bernardins : les salles contemporaines situées sous le parvis.
Sources :
Guide du patrimoine Paris, sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, Paris, Hachette, 1994.
Le collège des Bernardins
Adresse : 18-24 rue de Poissy
Métro : Maubert-Mutualité
Arrondissement : 5e
Téléphone : 01 53 10 74 44